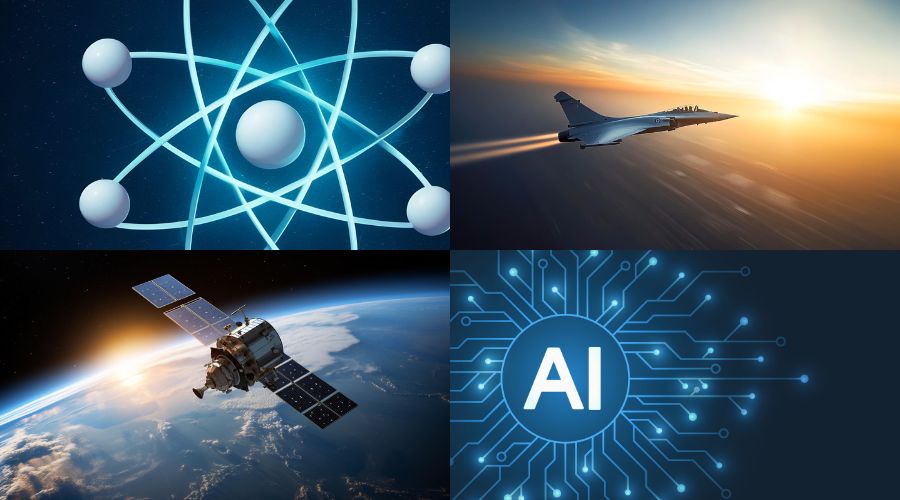Guerre en RDC, l’Union Européenne suit elle la bonne approche ?

Article paru dans La Tribune le 10 avril 2025
Le conflit actuel entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda remonte aux années ’90. Depuis donc pratiquement 30 ans, aucun processus de résolution n’a été réellement mis en place par les acteurs, par des instances internationales, ou par l’Europe. Mais s’agit-il réellement d’une guerre entre États ? Ne faut-il pas tenir compte de beaucoup d’autres facteurs, et développer des processus de résolution appropriés ? Par Gérard Vespierre, analyste géopolitique.
Le conflit entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda est complexe, enraciné dans des tensions politiques et économiques, mais il est aussi conforté par le manque de bonne gouvernance. Il se concentre principalement dans l’est de la RDC, le Kivu, très riche en ressources naturelles. Le Rwanda est accusé de soutenir le groupe rebelle M23, actif dans le Nord-Kivu, tandis que Kigali affirme vouloir protéger ses intérêts sécuritaires face à des groupes armés hostiles opérant depuis la RDC.
Le M23, ou Mouvement du 23 Mars, est un groupe armé formé en 2012 par d’anciens rebelles intégrés dans l’armée congolaise. Ils reprochent au gouvernement de Kinshasa de ne pas avoir respecté les accords de paix signés en 2009. Le M23 a repris les armes en 2021, et a gagné du terrain au début de cette année. Son rôle est controversé : certains le voient comme un outil du Rwanda pour influencer la région et accéder aux ressources naturelles, tandis que d’autres soulignent ses revendications liées à la protection de la communauté Tutsie.
A la lumière de ces éléments, on constate que ce conflit ne constitue pas une guerre ouverte entre deux États, mais représente le choc de différences ethniques, d’intérêts économiques privés, avec d’importants dispositifs de corruption, touchant les sphères politiques, du Kivu à Kinshasa.
Le cheminement de l’Union Européenne
Il faut donc dégager un processus de stabilisation qui tienne absolument compte d’une caractéristique fondamentale, à savoir l’hybridité de la situation. Au lieu d’un processus rigide, il faut dégager un cheminement souple, tant dans le nombre de partis qui doivent être représentés (y compris le M23 que Kinshasa a longtemps exclu)) que dans le calendrier, et la formulation des mesures de résolution à adopter.
L’implication européenne dans le règlement de ce conflit, long, n’a pas été particulièrement efficace. Pourtant le coût humain en est particulièrement élevé. Selon les estimations disponibles, le nombre de morts s’exprime en centaines de milliers, celui des blessés en dizaines de milliers, et ce sont plusieurs millions de personnes qui ont été déplacées, à l’intérieur de la RDC, ou se sont réfugiées dans les pays voisins.
L’UE a exprimé son soutien à la RDC face aux offensives du groupe rebelle M23. En 2024 Bruxelles a lancé une batterie de sanctions contre des membres du M23 ; en juillet de la même année, l’aide militaire envers le Rwanda est suspendue. Plus récemment, le 17 mars 2025, des sanctions ont été prises contre certaines personnalités et entreprises rwandaises impliquées dans le conflit, conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
On connaît malheureusement les effets limités, ou au moins tardifs des sanctions, qui plus est, vis-à-vis d’interlocuteurs non gouvernementaux. D’autre part, une stratégie de sanctions, très précise et concentrée, ne reflète pas l’enchevêtrement des racines du conflit, la pluralité des causes. Cette diversité d’origines implique une diversité des champs de résolution.
Paris et Bruxelles ont invité le président du sénat congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné d’une délégation de sénateurs, fin mars. L’Union Européenne souhaitait ainsi consolider les engagements européens en faveur de la paix et de la sécurité dans la région. Mais une telle démarche ne représente pas un format permettant d’engager un réel processus de règlement. Elle n’offre donc pas de résultat possible.
Naturellement Bruxelles s’applique à soutenir les initiatives diplomatiques aboutissant au dialogue, mais sans toutefois organiser ce dernier. Cette stratégie risque d’accentuer la perte d’influence européenne dans la région des Grands Lacs. Les initiatives politiques de résolution de ce conflit se situent donc ailleurs.
L’inattendue médiation qatarie
Doha a en effet organisé le 19 mars, une réunion entre Félix Tshisekedi, président du Congo, et Paul Kagame, président du Rwanda. Les deux présidents se sont donc entendus pour engager des discussions de paix et ont décidé un cessez-le-feu immédiat, et inconditionnel.
Cette réunion se tenait au lendemain du jour où devait intervenir une discussion en Angola, à Luanda, entre la RDC et le groupe armé rebelle M23. Ce dernier a annulé sa participation à la suite d’une série de sanctions décidées par Bruxelles, la veille de cette rencontre. Une action qui, selon le M23 sabote le processus en prenant parti pour la RDC. On retrouve dans cette réaction l’inadéquation du profil des décisions de l’UE, par rapport au profil du problème.
La diplomatie qatarie s’est donc posée habilement en médiateur, et non pas en soutien à l’un ou l’autre des partis. Ces pourparlers ont également mis en avant la nécessité de poursuivre les discussions dans le cadre d’un processus de médiation régionale, tels que ceux déjà entrepris à Luanda et Nairobi. Il a même été convenu de les coordonner afin de renforcer leur efficacité. Les négociations se poursuivent à ce jour, dans un contexte de baisse de l’intensité des combats. Le M23 a d’ailleurs évacué la ville de Walikale pour favoriser le dialogue.
Ces discussions offrent un nouvel espoir pour une résolution pacifique, bien que des défis majeurs restent à relever, à savoir le retrait des groupes armés du Kivu, l’instauration d’un dialogue inclusif, et finalement, les garanties sécuritaires régionales. Cela sera-t-il l’occasion d’inviter prochainement des représentants du M23 à se joindre aux discussions, directement, ou dans un premier temps, séparément ?
Les deux présidents, Paul Kagame et Félix Tshisekedi ont tenu à exprimer leur reconnaissance envers Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, soulignant l’importance du rôle de médiateur joué par Doha, et les progrès obtenus.
Des voix européennes se lèvent néanmoins pour appeler, dans le cadre de ce conflit, à plus d’efficacité dans la politique extérieure de l’Union. Une levée des sanctions, par exemple, pourrait participer à réduire l’isolement de l’UE.
Plusieurs responsables européens, à l’image Hilde Vautmans, ont souligné l’importance de transformer les engagements en actions concrètes, afin de parvenir à garantir la souveraineté, et l’intégrité territoriale de la RDC.
Souhaitons que nous puissions voir à l’œuvre dans la résolution de ce conflit, à la fois, l’efficacité d’une médiation régionale, et des engagements européens porteurs de résultats.